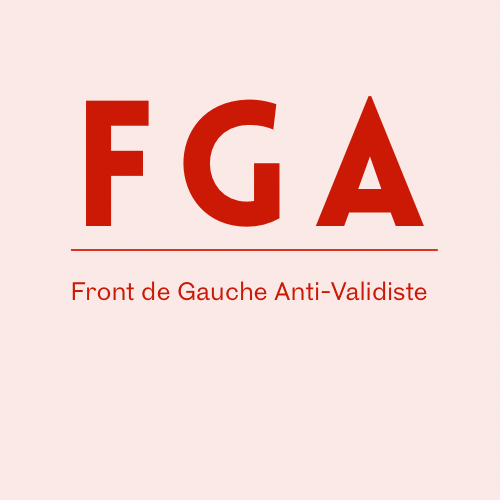Du Front de Gauche Anti-validiste (FGA)
REFERENCE: CRPD/2025/JA/ro
Paris, le 9 août 2025
Madame, Monsieur,
En tant que coalition d’organisations de militants handicapés anti-validistes, et en réponse à la demande d’informations complémentaires envoyée par le Comité des droits des personnes handicapées à la France concernant la proposition de loi T.A n°122, relative au droit à l’aide à mourir, votée en première lecture à l’Assemblée Nationale, le 27 mai 2025, nous souhaitons porter à votre attention les éléments suivants :
Eléments que le FGA porte à l’attention du CDPH concernant la proposition de loi relative à l' »aide à mourir »
Les critères d’éligibilité proposés, notamment “être atteint d’une affection grave et incurable” et « “présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable» sont conformes à la Convention, car elles semblent fondées sur des perceptions capacitistes de la qualité et de la valeur de la vie des personnes handicapées, notamment l’idée que la « souffrance » est intrinsèque au handicap, sans reconnaître que l’inégalité et la discrimination causent et aggravent la « souffrance » des personnes handicapées.
Nous sommes particulièrement préoccupés par ces critères d’éligibilité, qui ont été présentés comme stricts par le gouvernement mais qui ne le sont pas en réalité.
Les termes « affection grave et incurable » sont très larges et englobent de fait un nombre considérable de personnes malades et handicapées, tous types de handicaps confondus, dont les problèmes de santé peuvent être chroniques, évolutifs, potentiellement graves ou mortels, sans nécessairement être « en phase terminale » et dont la mort n’est ni imminente, ni même prévisible. « Présenter une souffrance physique ou psychologique constante » est également une condition imprécise. La référence à un critère uniquement psychologique semble indiquer que la loi s’appliquera aux personnes présentant des maladies psychiatriques qui ne sont pas formellement exclues du dispositif. L’expression « liée à cette affection » établit un lien clair entre la maladie grave et la souffrance psychologique. Elle conforte sans aucun doute l’idée que la souffrance notamment psychologique est intrinsèque à la maladie et au handicap et ne tient aucun compte des déterminants sociaux (inégalités, discriminations) qui causent ou aggravent cette souffrance.
Face aux craintes exprimées devant ce texte, la Ministre chargée des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq a, sur les réseaux sociaux, prétendu que la proposition de loi ne visait pas les personnes handicapées et qu’il était « faux et irresponsable de prétendre que ce cadre mettrait en danger les personnes en situation de handicap. » Avec d’autres élus, qui ont tenu les mêmes types de propos, elle semble opérer une distinction artificielle entre maladie et handicap. Une distinction qui occulte le fait que la maladie est une notion médicale tandis que le handicap est une catégorie sociale qui prend en compte l’interaction entre des limitations et des obstacles qui empêchent la participation à la société. La définition du handicap issue de l’article 1 de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées mentionne des limitations qui peuvent être physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles.
Or, ces limitations ont souvent pour cause la maladie. Ainsi, si toutes les personnes handicapées ne sont pas malades, de très nombreuses personnes malades sont handicapées. Par conséquent, il est évidemment faux de prétendre que la proposition de loi ne concerne pas les personnes handicapées.
Par ailleurs, le fait que la personne éligible au suicide assisté et à l’euthanasie doit, selon le texte, être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » et ne pas avoir « le discernement gravement altéré » ne constitue pas une garantie suffisante et fiable, tant l’appréciation de cette volonté et l’altération du discernement est complexe, subjective et peut être variable d’un médecin à l’autre.
Que la législation proposée garantisse le droit de choisir des personnes handicapées, en garantissant la disponibilité d’alternatives à l’aide médicale à mourir, telles qu’un soutien formel et informel, qui respecte leur autonomie, leur volonté et leurs préférences.
La proposition de loi prévoit uniquement l’obligation pour le médecin saisi de la demande de suicide assisté et d’euthanasie, d’informer la personne éligible des traitements et des dispositifs d’accompagnements disponible, et de la possibilité de bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs. Néanmoins, rien n’assure que la personne concernée pourra avoir accès de façon effective aux alternatives mentionnées.
En France, le droit à l’autonomie prévu par l’article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées n’est pas respecté et la liberté des personnes malades et handicapées est des plus réduite quel que soit le domaine. Les aides financières, comme les aides humaines et matérielles à domicile sont dramatiquement insuffisantes, et le handicap et la dépendance conduisent à l’exclusion et à la relégation dans des institutions. La plupart des personnes handicapées vivent ainsi dans la pauvreté, ne choisissent ni leur lieu, ni leurs conditions de vie ou de soins, ni leurs aidants et sont soumises à d’innombrables pressions d’ordre familial, médical, et institutionnel. Pour ce qui est des besoins en soins palliatifs, ceux-ci ne sont couverts qu’à hauteur de 50%, autrement dit seuls la moitié des patients qui en ont besoin y ont accès : par exemple, une vingtaine de départements sont dépourvus d’unités de soins palliatifs. Compte-tenu des politiques publiques menées, qui contribuent à organiser la précarité et la dépendance des personnes handicapées, les privent de la maîtrise de leur existence, et fragilisent leur accès aux soins, il est particulièrement hypocrite de prétendre, comme le fait le gouvernement, qu’elles pourraient soudainement retrouver leur entière liberté au moment – seulement – du choix de leur mort.
Avec ce texte, de nombreuses personnes malades et handicapées risquent donc de se retrouver contraintes de demander à mourir, non par réelle envie de mettre fin à leurs jours, mais parce qu’elles n’auront tout simplement plus les moyens de se soigner, de continuer à vivre et d’échapper à des souffrances auxquelles la société pourrait remédier si elle en faisait sa priorité.
Que le texte proposé garantisse que le consentement n’est pas donné par des tiers, des tuteurs ou des membres de la famille, mais par les personnes handicapées elles-mêmes, et qu’elles seront protégées contre la coercition, l’abus d’influence et l’abus de pouvoir.
Rien n’est prévu pour protéger les personnes handicapées éligibles contre la coercition, l’abus d’influence et l’abus de pouvoir. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne qui a demandé à mourir a seulement l’obligation de vérifier qu’elle ne subit aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent, le jour de l’administration du produit létal, soit très tardivement dans le processus. De plus, la proposition de loi ne comporte aucune précision sur la façon dont ces pressions seront évaluées par le médecin ou l’infirmier en cause, ce qui pose une difficulté compte-tenu du fait que les situations d’emprise sont particulièrement complexes à identifier.
Concernant les personnes privées de leur capacité juridique et placé sous un régime dit « de protection » (tutelle par exemple), la loi dispose que la personne chargée de la mesure de protection doit être informée, qu’elle peut présenter ses observations au collègue pluridisciplinaire qui instruit la demande qui devra en tenir compte, et qu’elle peut saisir le juge en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Autrement dit, la loi prévoit en théorie que seule la personne malade et handicapée est décisionnaire, tout en accordant une place à la personne chargée de la mesure de protection qui peut intervenir dans le processus pour s’assurer de la volonté du demandeur. Toutefois, en pratique, nous remettons en question le principe même que la parole de la personne malade et handicapée puisse être exempte de pressions dans le domaine du suicide assisté et de l’euthanasie, compte tenu des circonstances évoquées précédemment, c’est-à-dire du caractère défaillant du système de soins et de l’absence d’accès véritable à l’autonomie de vie pour les personnes concernées.
Que les informations fournies aux personnes handicapées soient accessibles et que des moyens et modes de communication alternatifs soient disponibles sur demande.
La proposition de loi prévoit que le médecin doit donner, uniquement aux personnes privées de leur capacité juridique et sous mesure de protection, « une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. » En dehors de l’hypothèse d’une mesure de protection juridique, rien n’est prévu concernant l’accessibilité et les moyens de alternatifs de communication disponibles pour informer les personnes handicapées éligibles sur le suicide assisté et l’euthanasie et leur fonctionnement. Une telle accessibilité serait de toute façon insuffisante à nos yeux pour garantir la compréhension du dispositif, notamment par les personnes présentant un handicap mental, intellectuel ou cognitif. Le suicide assisté et l’euthanasie soulèvent en effet des questions existentielles longues et complexes à appréhender, qui ne sont pas purement pratique mais touchent à des concepts abstraits, tels que la mort, le suicide, la vie et son sens. L’accompagnement dans la réflexion concernant un choix aussi grave et majeur qu’une décision conduisant à la mort nécessite du temps, de la disponibilité, de la formation, des moyens humains importants qui sont déjà difficiles à mettre en œuvre pour des personnes bien portantes et donc à fortiori pour des personnes handicapées, ayant des besoins spécifiques en la matière. La dégradation du système de soins ne permettra pas en pratique de trouver des médecins en capacité de s’adapter et de fournir des informations accessibles aux personnes concernées.
Arguments contre les éléments constitutifs de la proposition de loi « aide à mourir »
« Une personne qui tente de dissuader quelqu’un d’être euthanasié ou de se suicider avec assistance sera passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Ce délit d’entrave à « l’aide à mourir » puni de lourdes peines n’est aucunement justifié et particulièrement préoccupant. Il dispose qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ». Il sanctionne également les « pressions morales ou psychologiques » dissuasives exercées sur les patients, leur entourage et les soignants susceptibles d’entraver l’exercice de ce droit. La définition du délit d’entrave à « l’aide à mourir » est ainsi très large. Elle n’incrimine pas seulement les violences, les menaces ou les perturbations diverses mais également avec les termes « transmission d’allégations ou d’indications », toutes opinions ou discussions sur le suicide assisté et l’euthanasie qui pourraient être qualifiée de « dissuasives. » Parallèlement, aucune disposition pénale n’est prévue pour des personnes qui inciteraient à recourir à « l’aide à mourir ».
Avec la création de ce délit, qui n’existe dans aucun autre pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la proposition de loi vient en définitive criminaliser la prévention du suicide à l’égard des personnes malades et handicapées. Celui-ci constituera une menace certaine pour tous les proches et les soignants qui voudront jouer un rôle protecteur et dénoncer d’éventuelles pressions ou abus.
« deux jours seulement après avoir demandé le suicide assisté ou l’euthanasie, une personne peut être légalement mise à mort »
Le délai de réflexion de 48 heures donné par le texte à la personne ayant demandé le suicide assisté et l’euthanasie, pour confirmer sa demande après sa validation et mettre en œuvre le dispositif apparaît particulièrement court.
Ce délai ne tient pas compte du caractère fluctuant et ambivalent qui caractérise les idées suicidaires. De plus, il est à mettre en perspective avec les délais d’attente qui existent pour accéder aux soins et aux aides dont les personnes handicapées ont besoin et qui sont quant à eux extrêmement longs. Ainsi, concernant, par exemple, l’accès aux centres anti-douleurs, ils dépassent les six mois en France pour obtenir un premier rendez-vous et débuter un suivi.
Concernant l’accès aux principales aides (financières, humaines, techniques), les délais moyens de traitement des dossiers par l’instance compétente, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, peuvent aller jusqu’à 18 mois dans certains départements. Ce délai de 48 heures pour confirmer la demande de suicide assisté et d’euthanasie peut aussi être comparé à d’autres délais légaux beaucoup plus longs instaurés en matière médicale pour des actes certes graves mais moins lourds de conséquences. La vasectomie, par exemple, est soumise à un délai légal de réflexion de 4 mois entre la première consultation et la date d’intervention.
Si la loi est définitivement adoptée, la demande de mort via l’accès à « l’aide à mourir » deviendra donc la démarche la plus simple et la plus rapide auxquelles les personnes handicapées auront accès, ce qui ne manquera pas d’inciter celles qui seront les plus en difficultés à y recourir en priorité.
Mesures adoptées pour garantir que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient étroitement consultées et activement impliquées dans le processus d’élaboration de ce projet de loi.
Aucunes mesures n’ont été prise pour s’assurer que des organisations représentatives de personnes handicapées, au sens de l’article 4 de Convention relative aux droits des personnes handicapées et de l’Observation N°7 de l’ONU du 9 novembre 2018 relative à la participation des personnes handicapées, soient consultées et impliquées dans le processus d’élaboration de cette proposition de loi.
En effet, il convient de relever, d’une part, que seul le Conseil national consultatif des Personnes handicapées (CNCPH) l’instance consultative qui est supposé organiser la participation des personnes handicapées ou de leurs représentants à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, s’est officiellement prononcé sur le texte. Toutefois, cette
instance n’est pas composée d’organisations « de » personnes handicapées, dirigées et administrées par des personnes handicapées. La moitié des sièges du collège supposé représenter, depuis 2023, les associations de personnes handicapées n’est pas pourvu, l’instance reste donc toujours majoritairement composée d’associations gestionnaires de
services et d’institutions spécialisées « pour personnes handicapées » et donc non représentatives au sens de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées. Le CNCPH a d’ailleurs rendu, le 24 mai 2024, un avis favorable concernant la proposition de loi, très dommageable aux intérêts des personnes handicapées. Cet avis déplore, de façon incompréhensible, que la proposition soit encore trop restrictive et ne s’applique pas aux mineurs et aux personnes handicapées ayant des déficiences intellectuelles, ne tenant aucun compte des pressions que peuvent subir les personnes handicapées en cause et du discours validiste qui entoure l’adoption de ce texte.
D’autre part, il faut aussi souligner que durant la Convention citoyenne sur la fin de vie de mars 2023, organisée par le gouvernement pour prétendument consulter un échantillon de la population française au sujet de ce projet de loi, les personnes handicapées n’ont pas été représentées. Ainsi, ni la santé, ni le handicap ne figuraient au nombre des critères retenus dans le choix des participants supposé illustrer « la diversité de la société française. » Il est donc impossible de savoir dans quel pourcentage des personnes malades et handicapées ont participé à cette Convention. De même, durant ses travaux, aucune table ronde, aucune discussion n’a eu lieu avec des experts malades et/ou handicapées concernant leurs craintes autour ce texte et leurs conditions de vie et d’accès aux soins.
Force est de constater qu’à chaque consultation, il a été demandé à des personnes majoritairement valides de se prononcer sur ce texte en se projetant de façon fictive dans des réalités (la maladie, la dépendance, le handicap, la souffrance physique et morale, la proximité de la mort) qu’ils ne vivent pas mais craignent sans les connaître, tandis que la voix des personnes handicapées, qui font déjà l’expérience concrète de ces réalités, a été opportunément écartée ou minorée alors qu’elle aurait dû être prépondérante pour ne pas dire décisive.
Cette situation nous a contraint, en tant qu’organisations de personnes handicapées antivalidistes, à former une coalition et prendre la parole publiquement afin de faire entendre nos arguments sur les dangers que représente ce texte. Nous l’avons fait à travers la publication dans la presse d’une lettre ouverte adressée aux députés, le 22 mai 2025, qui a recueilli plus de 2000 signatures en moins d’une semaine.
Mesures visant à garantir que les autorités de l’État partie s’abstiennent d’affirmer dans les médias publics et les réseaux sociaux que le Comité soutient la légalisation de l’euthanasie.
La Ministre chargée des personnes handicapées, Madame Charlotte Parmentier-Lecocq a laissé entendre dans une intervention vidéo du 13 mai 2025 que l’ONU soutenait la légalisation du suicide assisté. Tout en affirmant que la proposition de loi ne ciblait pas les personnes handicapées, elle a également déclaré de façon incohérente que « l’aide à mourir » instaurée par le texte était « accessible à toute personne en situation de handicap, comme le prévoit la Convention des droits des personnes en situation de handicap des Nations unies ». Des propos qui suggèrent que la Convention relative aux droits des personnes handicapées contiendrait des dispositions qui feraient la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, voire consacreraient un « droit au suicide assisté et à l’euthanasie », ce qui n’est évidemment pas le cas. Le droit à la vie garanti par l’article 10 de la Convention n’a en revanche pas été rappelé par la Ministre. Cette déclaration est d’autant plus scandaleuse que la France ne respecte pas les engagements internationaux en matière des droits des personnes handicapées, refuse notamment toujours de respecter le droit à l’autonomie de vie prévu à l’article 19 de la Convention et d’engager concrètement le processus de désinstitutionalisation requis.
Cadre légal existant en France sur la fin de vie
Nous tenons à attirer l’attention du Comité sur le fait que dans le domaine de la « fin de vie », la France dispose déjà d’un cadre légal issu des lois Claeys-Leonetti (respectivement adoptées en 2005 et 2016). Celui-ci permet déjà aux malades dont le pronostic vital est engagé à court terme, c’est-à-dire dont le décès est attendu dans les quelques heures à quelques jours, de s’opposer à tout acharnement thérapeutique inutile et de bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Des souhaits qui peuvent également faire l’objet de directives anticipées. Les textes actuels proposent ainsi une réponse équilibrée, raisonnable et suffisante aux personnes concernées. Ils répondent d’ailleurs à la majorité des situations comme
le confirme une mission parlementaire d’évaluation de mars 2023. Par conséquent, en tant que personnes malades et handicapées, nous pensons que la réforme envisagée tendant à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie n’est pas nécessaire et représente plus de dangers pour les personnes concernées que de bénéfices pour quiconque. A fortiori, dans un contexte dans lequel le système économique et l’abandon des politiques de santé publique fragilisent les personnes malades et handicapées, tout en augmentant leur nombre, et où les idées fascisantes et eugénistes se déploient sans complexe à l’échelle mondiale. Aucune garantie, quelle qu’elle soit, ne sera de nature à sécuriser la proposition de loi en cause et à prévenir, d’une part, que des personnes malades et handicapées se dirigent vers ce dispositif par défaut, d’autre part, qu’il soit étendu à toujours plus de malades. Les exemples étrangers, comme celui du Canada, en attestent. Au nom du principe de précaution, il apparaît donc urgent que la France renonce à texte.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à nos présentes observations, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre parfaite considération.